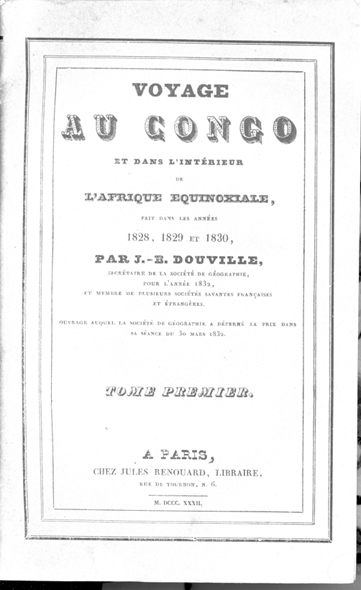Tom. I
Pag. 94 -95
Les nègres qui vivent loin des sentiers fréquentés par les voyageurs ne s’occupent que de la pêche, et passent le reste de leur temps à fumer leur pipe (cachimbo). Les femmes labourent le coin de terre dont la récolte est nécessaire à la subsistance de la famille; elles font la cuisine, s’occupent en un mot de tout ce qui concerne le ménage. La femme est tellement persuadée qu’elle n’existe que pour les plaisirs de son mari, et pour son service, qu’elle ne murmure jamais de sa nonchalance. Quant à lui, indolemment étendu à l’ombre de grands arbres, il sommeille en attendant le dîner, il regarde tranquillement sa compagne pendant qu’elle se fatigue à piler le maïs qui doit le nourrir; enfin, lorsque le repas est prêt, elle le sert et se contente de ses restes: encore va-t-elle les manger loin de lui.
Pag. 109-115
Ces peuples (Zenza do Colungo, Angola) ont une telle confiance dans leurs devins que, pour connaître la cause de leurs infirmités, ils consultent toujours ces jongleurs avant de s’adresser à leurs médecins: ils ne croient pas que ceux-ci puissent la découvrir; ils pensent que leur science se borne à appliquer les remèdes lorsque le sorcier leur a indiqué l’origine du mal.
Quibuco et Muta Calumbo sont les dieux principaux et les plus renommés dans ce district. Cependant j’appris par le receveur des impôts que le régent de cette province, qui avait attendu en vain depuis long-temps la guérison des ulcères de sa jambe sans que Quimbuco parût y prendre garde, s’était enfin résolu à envoyer un de ses esclaves consulter un dieu dort renommé dans une province voisine, et qu’il attendait le retour de son émissaire dans quelques jours. Aussitôt il me vint dans l’idée de connaître le résultat de cette consultation. Je ne communiquai pas d’abord mon intention au receveur, parce que descendant lui-même d’une famille nègre, et par conséquent aussi superstitieux qu’ils le sont tous, puisqu’il ne voyageait jamais sans son Quibuco, il aurait pu me trahir tout en faisant semblant de rire de la crédulité générale.
L’arrivée de l’esclave quelques heures après, et pendant que tout le monde dormait, me procura le moyen de satisfaire ma curiosité. Assis dans une petite salle à côté de celle du régent, j’entendis le récit de l’envoyé. Voici la conversation qui eut lieu entre ces deux hommes; elle fera voir à quels excès est portée la superstition, même des gens que le gouvernement portugais revête de dignités, parce que, trompé par leur amour apparent pour la religion catholique dont ils suivent extérieurement tous les rites, il croit voir en eux des prosélytes de la foi. L’esclave arrive.
L’esclave. Bonjour, mon maître.
Le régent. Entrez. Qui est-ce?
L’esclave. C’est moi, mon maître.
Le régent. Que je suis aise de ton retour! Je soupirais après le moment de te voir. Donne-moi des nouvelles de la divination. Quelle est la cause de ces ulcères qui me rongent la chaire et me rendent si maigre au moment où je pensais m’engraisser de la fortune de ceux qui ont ici leurs requêtes, et surtout du partage que j’ai à faire dans la famille des Quincanguelas et de mon défunt ami Théodore? Enfin raconte-moi le résultat de ton voyage.
L’esclave. Vous vous occupez de fortune; mais la santé avant tout: examinons la réponse du devin.
Le régent. Voyons, parle. Mais pendant ton absence, j’ai aussi envoyé consulter un autre devin. Je te dirai d’abord que je suis désolé, parce que j’ai reconnu hier que je suis mal avec mon Muta Calumbo. Il n’y a donc rien d’étonnant que tout aille mal, et que rien ne me réussisse. Il est vrai que c’est ma faute; car j’aurais du faire bâtir ce temple que je lui avais promis si j’obtenais la régence.
L’esclave. J’ai couru jusqu’aux confins de la province, parce que j’étais sûr de n’y trouver aucun de vos ennemis qui auraient pu solliciter le dieu contre vous. Là, cherchant le devin Vandimen, j’appris chez les fils de Caznengongo qu’il était allé chez la soeur de Camargos, à Ambacca, pour la dédicace d’un temple à Quibuco. Prenant ensuite intérêt au chagrin que cette nouvelle me causa, ces gens me dirent, en me montrant un nègre initié dans l’art de la divination: «Suis cet homme; il te conduira chez le grand Caznengongo.»
Aussitôt que j’arrivai chez celui-ci, je lui parlai de votre maladie et des ulcères qui vous rongent… Il me répondit d’une voix de tonnerre, mais majestueuse: «Vas-t’en; ta commission n’est pas de ma compétence. Je te dirai cependant que l’individu qui est ainsi affligé doit cesser de boire du tafia, sinon il deviendra bientôt fou». En parlant ainsi, le grand Caznengongo avait les yeux fixés sur une marmite remplie d’un liquide qu’il considérait avec attention. Il ajouta: «Tu peux te convaincre par toi-même de ce que je dis. Vois cette figure qui paraît dans cette chaudière; n’a-t-elle pas l’apparence d’un homme ivre? Hé bien, c’est l’état où ton maître se met tous les jours». Jetant les yeux sur une autre marmite, j’y vis la figure d’un fou; il ajouta: «Cette figure représente l’état futur de ton maître.»
Cette réponse ne me satisfit pas; je voulais connaître les moyens de guérir vos plaies; alors je le priai de condescendre à ma demande, afin que je pusse remplir complètement ma mission, mais il me répéta d’une voix terrible et sourde: «Retire-toi, je ne communique point avec les dieux-médecins; je ne consulte que le dieu de la foudre, auteur de toute justice. Tous les magiciens conviennent qu’il est le plus grand et le plus puissant. D’ailleurs les dieux dont nous reconnaissons la puissance, tels que Fito Gnatio, Gran José, Llaqui Guli, Venda Lugulu, Quilango, Vahuezc, lui cèdent eux-mêmes le premier rang. Enfin il est attesté aujourd’hui que Muta Calumbo, qui pendant très long-temps avait obtenu la supériorité, ne peut prononcer des oracles comparables à ceux de Lamba Lianquita, dieu de l’éclair et maître suprême de tous les magiciens. Je ne puis interroger le dieu, sur ce que tu demandes; ce serait contraire à ce que je jurai quand Lamba Lianquita s’empara de mes esprits. D’ailleurs je sais que ton maître adore Muta Calumbo. Je te dirai encore que quiconque honore ce dieu et fait évoquer Lamba Lianquita, celui-ci, pour montrer l’infériorité de l’autre dieu, fait périr le mortel qui ne croit point en lui. Va à Ambacca, vers Couen Quichamba…» Il allait me donner un conseil, quand tout-à-coup un dieu s’empara de ses esprits… Il resta un moment interdit: puis il commença à beugler. Il resta dans cet état pendant quelque temps. Un peu remis de la convulsion subite dans laquelle l’apparition du dieu l’avait jeté, il me dit: «Fuis, malheureux! fuis, ne tarde pas un instant. Mon père Quibigi Quianona va paraître; tu cours grand risque de perdre la vie dans l’entrevue que je vais avoir avec lui.» Il avait à peine achevé de parler, qu’une odeur de souffre rempli la maison et me força à décamper à toutes jambes pour éviter d’être suffoqué.
Le régent. C’est bon, en voilà assez. Tu as voyagé comme un cheval; tu as vu comme un âne, et tu parles comme une bête… Depuis quand le tafia fait-il mal? Ce qui nuit à la santé, c’est le vin; aussi je n’en bois que quand mes amis de Loanda m’en envoient en présent… mais quant à ma plaie, sans être devin, j’en ai trouvé la cause… Ce sont mes ennemis, mes compatriotes, qui m’ont jeté un sort, parce que je suis régent de ce district… Mais c’est une chose infâme de voir jusqu’où la méchanceté conduit les hommes!!!… Qu’y a-t-il de plus horrible que de vouloir nuire à ceux qui nous gouvernent… Mais en définitive est-ce un crime?… Est-ce ma faute si j’ai été nommé régent de Zenza do Golungo? Mes rivaux n’ont-ils pas un quibuco comme moi?… Si le mien m’a été favorable, ai-je obtenu ses bonnes grâces par quelque méfait? Doivent-ils m’en vouloir, si par leur insouciance ou leur négligence pour les rites de Muta Calumbo, dieu aussi ancien que les hommes, que nos ancêtres ont révéré, dont ils nous ont transmis le culte, et, que nous devrions vénérer, ils se sont vus réduits à la misère?… Ils ont tort, et ils ont accumulé faute sur faute en entourant ma maison d’idoles malfaisantes qui toutes ensemble contrebalancent la puissance de mon dieu; mais il succomberont à la fin; ce qui m’embarrasse pour le moment, ce sont les ulcères de ma jambe et de mon corps en général.
L’esclave. Oh! mon maître, oubliez tous les dieux qui vous entourent pour ne songer qu’à vos ulcères. Buvez peu de tafia, puisque les magiciens s’accordent à dire qu’il vous fera bientôt mourir. Voyons maintenant le médecin, puisque nous connaissons la cause du mal, il nous apprendra bientôt le remède nécessaire.
Le régent. Va… pars… ne reviens qu’en amenant deux des plus fameux médecins. Je veux leur expliquer la réponse du devin, et je prendrai les remèdes qu’ils ordonneront. Surtout garde-toi bien de rien dire de cela à personne, parce que si le gouverneur général apprenait que j’adore toujours nos dieux,… que je t’ai moi-même envoyé consulter les magiciens, il me retirerait sans doute, l’administration de cette province…»
Cette conversation à laquelle l’on aura de la peine à croire, et que néanmoins j’ai racontée avec la fidélité la plus scrupuleuse, prouve un fait très réel, quoique contesté, c’est que la conversion des nègres n’est que feinte; car celui dont je m’occupe passait pour un très bon chrétien, allait régulière ment à la messe et même se confessait assez souvent.
Si les hommes qui sont les plus éclairés de leur nation et auxquels le gouvernement portugais a même confié des emplois importants; si ces hommes, dis-je, continuent en secret a adorer leurs fétiches, n peut-on pas en conclure que le nègre de la classe inférieure, dont toute la religions consiste a avoir reçu le baptême, et qui connaît a peine le nom de Jésus-Christ, qu’il regarde comme un dieux inférieur a ceux qu’il révère, n’est pas moins adonné au culte des idoles, que ses compatriotes moins ignorants qui lui? D’ailleurs, deux jours après, j’allai dans une maison peu éloignée de celle du régent et où les nègres se réunirent en sortant de l’églisse pour célébrer une fête en l’honneur de Muta Calumbo.
Pag. 181
Les menuisiers ont une scie, un rabot, une herminette et un couteau; avec ces instruments, ils font des portes pour les maisons, et des tables pour ceux qui ont la prétention de devenir blancs. Il suffit pour avoir ce titre parmi les nègres, d’être chaussé et de porter des pantalons. La couleur de la peau n’y fait rien.
Tom. II
Pag. 270-277
Les nègres du royaume d’Angola et ceux de Benguela, de Quisama, de Libolo, de Tamb, de Cunhinga, de Bihé, de Baïlundo, offrent entre eux de nombreuses ressemblances dans les moeurs, les coutumes, les habitudes. Ces mêmes particularités les font aisément distinguer de ceux qui vivent au nord ou à l’est, et dont j’aurai occasion de parler dans la suite.
Les nègres dont je m’occupe peuvent être considérés comme appartenant à la même souche. Ils sont grands et bien faits; ils ont les épaules larges, le crâne très épais, les hanches contractées, ce qui leur donne une grande force de reins. Cependant il est facile de reconnaître les habitans du royaume conquis de ceux des autres pays nommés plus haut. L’attitude de ceux-ci est fière; ils marchent la tête levée, la poitrine effacée; ils ont un certain air d’audace qui sied au courage. Leurs fesses sont assez bien formées, leurs mollets bien marqués; leurs muscles se dessinent bien et indiquent une constitution vigoureuse. Les habitans du Bihé et de Baïlundo, ainsi que je l’ai déjà dit, l’emportent sur tous les autres par leur haute taille, et ont leurs cheveux taillés comme la crinière d’un casque.
L’habitant des royaumes d’Angola et de Benguela marche comme s’il était éreinté. Il porte la tête un peu inclinée. Son oeil noir manque de vivacité. Il a, comme les nègres des autres pays, l’estomac arrondi; mais toute sa personne annonce une nonchalance extrême. Il n’a point de mollets; ses genoux semblent fléchir sous le poids de son corps.
La mâchoire de tous ces peuples n’est pas beaucoup plus allongée que celle des blancs. Leurs muscles n’annoncent pas qu’ils aient plus de vigueur. A l’âge de dix-huit ou vingt ans au plus tard, la barbe leur pousse. Leur chevelure est laineuse, leur estomac un peu plus arrondi que chez le blanc, leur nez large, leur front déprimé; ils réfléchissent peu, et semblent être plutôt guidés dans leurs actions par leurs appétits que par aucune opération de leur raison. Ils ont peu de capacité intellectuelle, quoiqu’il s’en trouve parmi eux qui ont des prétentions à l’esprit. Les habitans de Baïlundo, de Bihé et de Tamba sont plus intelligens, plus intrépides et plus courageux que les autres, mais en même temps plus méchans. Toujours prêts à affronter les plus grands périls, ils ne calculent les dangers que lorsqu’ils ont accompli leur dessein. Turbulens à l’excès, ils restent à peine un moment à la même place, tandis que ceux des pays conquis passent des journées entières, assis à la porte de leurs cabanes, sans changer de position, ni même détourner les yeux d’un objet sur un autre.
Tous ces peuples sont polygames. Si quelques-uns, surtout dans le royaume d’Angola, sont monogames, ce n’est que par l’impossibilité de pouvoir se procurer plusieurs femmes. Ils observent régulièrement leurs cérémonies religieuses envers leurs fétiches. Ces pratiques varient dans les diverses contrées; mais le fétiche ou dieu est partout le même. Dans le royaume d’Angola, il y a des nègres qui ont reçu le baptême; mais j’ai déjà dit que c’est à quoi se borne leur christianisme. D’ailleurs, adorateurs d’idoles et mariés à plusieurs femmes, ils trouvent ce genre de vie plus convenable à leur nature et aux coutumes qu’ils ont héritées de leurs pères.
Indépendamment des dieux nombreux que les nègres adorent, ils leur ont consacré des insectes et des animaux sous la figure desquels ils pensent qu’ils se cachent souvent, et que par cette raison ils nourrissent soigneusement. On conçoit que ceux des pays soumis aux Portugais ne peuvent avoir de temples publics; chaque individu a chez lui ses fétiches. Dans toutes les provinces que j’ai parcourues, je n’ai vu nulle part de sacrifice humain; cependant on se souvient de ce qui manqua de m’arriver chez Cassundé. De plus chez Baca soba, au sud de Novo Rodondo, et à l’ouest du Quisama, j’ai vu l’emplacement où l’on immole des hommes: voici ce que les habitans me racontèrent. Lorsque l’on célèbre une grande fête, on conduit tous les criminels près du rivage de la mer, à une petite distance de la banza. Ensuite, le soba vêtu de ses plus beaux habits et entouré de ses macotas, arrive et s’assied sur une grande pierre plate taillée en forme circulaire; ses macotas prennent place autour de lui par terre; le plus grand silence règne dans l’assemblée, le peuple se tient assez loin en face du souverain. Un des avocats des criminels qui sont également placés vis-à-vis et plus près du soba, se lève et prononce un discours pour la défense de son client, en déployant toute son habileté pour prouver qu’il est innocent, ou du moins qu’il mérite le pardon; l’accusé ne peut se défendre lui-même, il a seulement la faculté de suggérer ses moyens de défense, mais à voix basse, à son avocat. Jamais celui-ci n’est interrompu ni exposé à aucune poursuite pour son discours, quand même on reconnaîtrait qu’il avance des faits évidemment faux.
Quand il a terminé son plaidoyer, le soba fait un signe aux macotas qui s’approchent et délibèrent si l’accusé est ou n’est pas coupable; la décision est prise à la majorité des voix. La consultation finie, chacun reprend sa place sans dire un mot. Un autre avocat prend ensuite la parole. Lorsque tous ont parlé et que le soba a délibéré avec les macotas, sur chaque criminel, il se lève et déclare que le plus coupable, qu’il désigne, a encouru la peine capitale. Les bourreaux le saisissent aussitôt, l’enveloppent dans un filet préparé pour l’occasion, et où il est si serré, qu’il ne peut bouger. On le suspend à deux branches d’arbre où il reste jusqu’au lendemain. Alors on le délie. Le soba paraît précédé des musiciens, et suivi de ses nobles et du peuple. Il prend place comme la veille, on fait silence, le criminel est amené près du fatal billot, le soba donne le signal, et en un moment, les membres du malheureux roulent à terre.
Les macotas détachent un morceau des chairs palpitantes, l’offrent au soba, en coupent un autre pour chacun d’eux, au milieu des démonstrations de la joie bruyante de la foule qui bientôt se dispute ces restes sanglans. Ceux qui en obtiennent un lambeau s’estiment heureux et conçoivent l’espoir de devenir macotas. On retourne ensuite à la banza où le reste de la journée est consacré à la débauche. Chacun fait griller le morceau de chair qu’il s’est procuré, et le mange en poussant des cris de joie.
Ces fêtes atroces montrent jusqu’à quel point ces nègres portent la cruauté. Cependant, la banza du soba Baca est à peu de distance de Novo Redondo, où les Portugais ont bâti un petit fort.
Le nègre souffre avec une patience incroyable; il pousse rarement un soupir, même au milieu des plus terribles tourmens. Il se détruit pour se venger de celui qui l’achète, ou même avant être vendu, afin de priver le soba du profit qu’il espère en le réduisant à l’esclavage. Quand il est résolu de périr, il invite son ennemi à se réconcilier, lui donne du poison, et en avale lui-même, afin d’arriver ensemble dans l’autre monde, et de terminer leurs différends en présence des personnes qui les ont connus pendant leur vie. Se venger d’un ennemi est un titre de gloire chez les sauvages, et y passe pour une action méritoire et courageuse.
Ce que le nègre craint le plus est d’être transporté au-delà des mers, parce qu’il est persuadé que le blanc le tuera et le mangera. Dans les premiers temps de la traite, les mères racontaient à leurs enfans des histoires pour les effrayer; à force d’être répétés, ces récits ont passé pour des vérités.
Les herbes, l’écorce ou la racine de certains arbres, sont les remèdes employés par les nègres pour toutes les maladies. Quand ils ne se trompent pas sur la nature du mal, ils sont assez heureux dans leurs cures. Leur ivrognerie est la cause de la plupart de leurs maux; ils ne vivent pas long-temps: on pourrait dire qu’ils ne font en quelque sorte que paraître et mourir. Ils s’enivrent presque tous les jours avec du tafia ou du oualo. Cette dernière boisson est extrêmement rafraîchissante, et cause un dévoiement très fort. La première irrite et enflamme les intestins. Toutes deux, également pernicieuses, minent peu-à-peu la santé de ces hommes, et abrègent leurs jours. Ils savent cependant qu’une décoction de l’écorce du panda arrête les effets d’une diarrhée, et quand ils la prennent à temps, elle leur sauve la vie.
Ils ne savent rien garder pour le lendemain; ils consomment en un jour toutes leurs provisions, quand même ils sauraient que la mort doit être le résultat de cet excès. Le oualo, leur boisson ordinaire, est bien approprié à leurs habitudes, car il ne peut se conserver que trois jours. On ne peut le boire les deux premiers, parce qu’il n’a pas fermenté; il n’atteint sa perfection que le troisième, et il s’aigrit le quatrième.
Le nègre ne se sert ni de couteau, ni de fourchette, ni de cuillère pour manger: il déchire la viande, il mange les haricots et l’infungi, ou bouillie de farine de manioc, avec les doigts; il boit les liqueurs à même du vase qui les contient. Il mène, dans son opinion, une vie heureuse. En effet, il ne manque de rien. Ses besoins comme ses desirs sont très bornés. Si deux ou trois femmes ne lui suffisent pas, il en prend une quatrième, une cinquième, et même un plus grand nombre s’il en trouve. Il passe le jour à causer avec ses amis, et la nuit dans les bras d’une de ses femmes. Il boit quand il a soif, il mange quand il a faim, il dort quand la force de la chaleur l’assoupit. Il se couche de bonne heure, et à la pointe du jour il est à la chasse. Il en revient à neuf heures du matin. Il se trouve bien comme il est; la civilisation pourrait-elle ajouter à sa félicité telle qu’il la conçoit?
Pour semer le millet, les haricots et les ognons, le nègre se contente de remuer la terre avec une houe, à la profondeur de deux ou trois pouces. Il ne sème qu’une fois l’an; cependant il pourrait faire trois récoltes. Les nègres ne cultivent jamais les champs voisins d’une banza, pour éviter que les animaux domestiques ne détruisent la moisson.
De même que les peuples civilisés, ils se réunissent dans des villages, pour pouvoir se défendre plus aisément. La ville où habite le souverain est toujours beaucoup plus grande que les autres. Le chef converse avec tout le monde, entretient chacun de ses affaires particulières, et semble compatir aux malheurs de ceux qui en éprouvent. Il fait distribuer quelques calebasses de oualo à ceux qui lui font visite; il boit avec eux, et se conduit en père de famille; personne cependant ne lui manque de respect. J’ai assisté plusieurs fois à ces audiences, où tout se passe dans la plus grande harmonie.
Mais ce souverain qui se montre si bon, est inexorable pour les gens qui commettent des fautes. Il fait charger leurs mains de chaînes, ce qui les rend esclaves à jamais. S’il reconnaît ensuite que les accusateurs ont agi par malice et à tort, il les fait prendre, et ils sont esclaves de droit.
Tom. III
Pag. 234-247
Habitans. Les peuples que j’ai vus appartiennent tous à la race nègre. L’intensité de leur couleur n’est pas la même partout. Les habitans du Bihé et les Molouas sont beaucoup plus noirs que ceux des autres pays que j’ai visités. Cependant ces Bihens et ces Molouas vivent dans les contrées les plus élevées au-dessus du niveau de la mer. Tous ces nègres, de même que ceux des autres parties de l’Afrique ont la peau très luisante, ce qui est dû à ce qu’ils l’enduisent de graisse animale; ceux qui ont la possibilité de se servir d’huile de palmier, emploient cet ingrédient.
Parmi ces nègres, ceux du Bihé se distinguent par leur grande taille; elle est en général de près de six pieds. Ils sont de plus bien faits, robustes, agiles, courageux et résolus. J’ai dit dans ma relation que j’avais trouvé chez eux les porteurs qui m’ont servi avec le plus de zèle, d’attachement et de persévérance, puisqu’il y en a eu parmi eux qui m’ont accompagné jusqu’au moment où j’ai dit adieu aux rivages de l’Afrique. Les Molouas sont ensuite les plus grands; leur taille ordinaire est de cinq pieds cinq pouces, quant aux autres nations elle est un peu moindre. Tous ces peuples sont forts; mais à mesure qu’ils se rapprochent de la ligne, leur vigueur paraît diminuer. Presque tous ont le front peu élevé, le nez épaté, et très éloigné de la bouche, les lèvres épaisses, le menton court et comme reculé en arrière, les mâchoires prolongées en avant; les oreilles très grandes, enfin les cheveux laineux qui deviennent gris avec l’âge.
J’ai reconnu par des expériences répétées, que le crâne des nègres contient de deux à quatre onces de moins que celui du blanc. La texture osseuse de leur crâne est plus épaisse, le cerveau est brun, les nerfs qui en sortent sont beaucoup plus gros que chez les blancs.
Quand les blancs qui ont séjourné quelque temps en Afrique sont attaqués des fièvres, ils vomissent une bile brune, quelquefois de couleur vert-bouteille et épaisse; il en est de même de leurs descendans.
Le nègre attaqué de la même maladie, vomit une bile noire, épaisse et floconneuse.
Quand le blanc, sans être atteint d’aucune maladie prend un vomitif, il rejette une bile jaune un peu foncée, mais claire.
Les nègres à qui je fis prendre des vomitifs comme préservatifs contre les fièvres, rendirent une bile vert-bouteille et épaisse.
Ce ne peut être la chaleur atmosphérique qui cause cette différence notable entre la bile du nègre et cette du blanc, puisque tous les deux ont été et sont également exposés aux rayons du soleil.
La chaleur du soleil ne peut être la cause de la couleur de la peau du nègre; en effet, l’expérience prouve le contraire. Il y a dans la province de Pungo Andungo, plusieurs familles blanches descendans des premiers colons portugais. Elles ont conservée leur teint blanc, et si elles étaient en France, personne ne présumerait qu’elles sont nées sous le climat brûlant de l’Afrique où leurs ancêtres vivent depuis trois siècles. Ce fait déjà connu, prouve mieux que tous les raisonnemens, que la chaleur atmosphérique ne suffit pas pour donner à la peau du nègre la teinte qui le caractérise. Les cicatrices de ses blessures ne deviennent jamais noires, quoique son corps soit constamment exposé au soleil. L’enflure qui affecte les jambes, et qui se termine ordinairement par un abcès qui ne se guérit qu’après plusieurs années de souffrances, rend, dans le principe, une matière visqueuse et noire, et quelques mois après une matière d’un rouge brun. Il n’en est pas ainsi dans les maladies du même genre qui attaquent les blancs.
L’observation suivante confirme l’opinion que le nègre est en tout différent du blanc. Le vingt-et-unième mois après mon arrivée en Afrique, je fus attaqué du ocutata gia quiba, maladie cutanée que je crois n’être pas connue dans les autres parties du globe; elle couvre la peau de gales purulentes. Le seizième jour, il s’établit chez moi une suppuration qui n’a lieu qu’après le vingtième chez le nègre. Je comparai la matière qui sortait de ces gales dont j’étais couvert avec celle qui suintait des gales des nègres: celle-là était d’un blanc jaune, et celle-ci d’un brun foncé bien marqué.
J’ai disséqué souvent des têtes et différentes parties des corps des nègres, et j’ai trouvé de grandes dissemblances de conformation comparativement à la nôtre.
Le sang du nègre mort est glutineux, noir et tellement épais qu’il semble ne former qu’une masse avec la chair.
A sa naissance l’enfant du nègre est d’un blanc cuivré, il n’a que les parties sexuelles de noires. Il ne commence à noircir qu’au bout de quinze jours. Les enfans sont moins noirs que les hommes parvenus à la virilité. Les vieillards deviennent d’un noir tirant sur le jaune. Le nègre malade perd sa teinte foncée et il est livide. La chair du nègre blessé est d’un rouge brun, son sang tire sur le brun foncé. J’ai fait plusieurs observations semblables sur les mulâtres, mais partout, où il y a eu mélange avec l’Européen on remarque des différences notables.
Un grand nombre d’expériences et d’observations répétées dans le même temps sur plusieurs individus de différens âges m’ont prouvé que le nègre jeune a le sang plus chaud que le nègre déjà avancé en âge, et que celui-ci a encore le sang plus chaud que le blanc dans la force de l’âge.
Ayant mis la boule d’un thermomètre sous la langue de divers individus, j’ai obtenu les résultats suivans.
A sept heures du matin avant que les individus fussent sortis et eussent été exposés au soleil;
Le mercure du thermomètre de Réaumur sous la langue d’un
blanc de 12 ans, s’éleva à 29 3/12
nègre 12 Id. 31 11/12
blanc 20 Id. 29 7/12
nègre 20 Id. 31
femme blanche 14 Id. 29 8/12
négresse 14 Id. 32 3/12
J’ai reconnu que cette différence d’environ deux degrés qui existait entre la chaleur du blanc et celle du nègre était due à la chaleur propre à celui-ci, parce, que le blanc, habitant de l’Afrique n’en acquiert jamais un aussi haut degré. C’est ce que démontrent les observations suivantes faites sur des familles habitant l’Afrique depuis long-temps; sur d’autres nées en Afrique, et enfin sur quelques individus nés de parens qui y étaient nés.
Comparaison entre une famille blanche qui habitait l’Afrique depuis plus de dix ans,
et les nègres indigènes.
Le mercure du thermomètre, sous la langue
d’un blanc de 14 ans, s’est élevé à 28 11/12
D’un nègre du même âge 31 7/12
D’un blanc de 25 ans 29.
D’un nègre de 25 Id. 31 1/2
Résultat de la comparaison entre un blanc né en Afrique et un nègre.
Le mercure du thermomètre sous la langue
d’un blanc de 13 ans, s’est élevé à 29 5/12
nègre de 13 31 7/12
blanc de 20 29 3/12
nègre de 20 31 1/12
Résultat de la comparaison entre le descendant d’une famille qui depuis cent soixante-quinze ans habite l’Afrique, et le nègre.
Le mercure du thermomètre sous la langue
d’un blanc de 12 ans, s’est élevé à 29 1/12
nègre de 12 31 5/12
blanc de 18 29 9/12
le nègre de l8 31 7/12
Voulant ensuite connaître si tous les nègres avaient le même degré de chaleur, j’ai obtenu les résultats suivans.
Première observation faite dans le mois de mai.
Le mercure du thermomètre sous la lange d’un nègre
stupide et paresseux de 18 ans, s’est élevé à 31 5/12
intelligent 18 Id. 31 1/12
intelligent et actif 18 Id. 30 11/12
Deuxième observation faite dans le mois de juillet.
Sur un plateau élevé de 1075 toises au-dessus du niveau de l’Océan, le mercure du thermomètre sous la langue d’un nègre
stupide et paresseux de 18 ans, s’est élevé à 30 11/12
paresseux 18 Id. 30 8/12
intelligent 18 Id. 30 4/12
intelligent et actif 18 Id. 30 1/12
Ces résultats montrent que plus l’homme est stupide, plus son sang est chaud. Il ne s’occupe de rien, la chaleur est concentrée entièrement dans son intérieur.
Des nègres exposés au soleil et d’autres enfermés dans leurs cabanes, où le soleil ne pénètre jamais, m’ont donné les résultats suivans:
Le thermomètre a marqué sous la langue d’un nègre inactif et paresseux
dans sa cabane 30 8/12
au soleil 31 2/12
D’un nègre actif travaillant au soleil 30 10/12
Cette expérience montre que la chaleur animale augmente par la respiration d’un air très chaud. Il est bon de noter que toutes ces observations ont été faites sur des nègres dans la force de l’âge, et livrés entièrement à l’ardeur des passions qui tiennent leurs corps dans une espece de fièvre brûlante; mais le nègre perd cette grande chaleur avec l’âge. Il vieillit très vite, et à l’âge de trente ans il est aussi vieux qu’un blanc de cinquante-cinq à soixante ans, et il est rare d’en trouver qui aient plus de quarante ans, mais le nègre vieux a une chaleur supérieure à celle du blanc, encore dans la force de l’âge. C’est ce que l’on voit par les observations suivantes
Première observation.
La boule du therm. sous la langue d’un nègre de 15 ans, le mercure
s’est élevé à 31 7/12
Id. Id. négresse 15 32
Id. blanc né en Afrique 20 29 8/12
Deuxième observation.
La boule du therm. sous la langue d’un nègre de 20 ans 31 3/12
Id. négresse 20 31 7/12
blanc né en Afrique 20 29 8/12
Troisième observation.
La boule du therm. sous la langue d’un nègre de 25 ans 31 1/12
Id. négresse 25 31 1/12
Id. blanc 20 29 8/1~
La négresse a une chaleur supérieure à celle du blanc quand elle est jeune, mais à l’âge de vingt ans, cette chaleur diminue et devient moindre que celle du nègre.
Cinquième observation.
La boule du therm. sous la langue d’un nègre de Loanda, de
54 ans, s’est élevée à 30 4/12
Sous la langue d’un blanc de 20 ans, Européen 29
Lorsque le nègre se livre à l’exercice de la danse, il répand une odeur si forte, que je la trouvais insupportable; ce qui vient probablement de ce qu’il se frotte le corps avec la graisse des animaux. Il leur est impossible de se livrer à cet exercice, sans ressentir des desirs effrénés, excités par les gestes et les mouvemens lascifs.
J’ai souvent entendu dire au nègre qu’il reconnaîtrait un blanc au milieu de mille individus de leur couleur, seulement par l’odorat. J’en ai fait plusieurs fois l’expérience en leur bandant les yeux et me mêlant à une foule nombreuse, ils ne manquaient jamais de venir droit vers moi. Ils me disaient que le blanc exhale une odeur suave qui les attirait en irritant leurs nerfs.
Lorsque je me trouvais à une grande distance de mes gens, et que je tardais à les rejoindre, très souvent ils venaient au-devant de moi, et me suivaient à la piste; ils reconnaissaient les traces de mes souliers, dans des endroits où je ne pouvais rien distinguer.
Les négresses sont en général plus petites que les hommes, et moins bien faites que les blanches. Les poils du pubis sont clairsemés; on les circoncit lorsqu’elles se marient, c’est-à-dire qu’on leur coupe le prolongement ou la saillie des nymphes qui a environ un pouce de long. Elles ont les fesses très grosses, de sorte que leurs enfans s’y tiennent d’eux-mêmes assis, et cramponnés avec les pieds sans être presque soutenus par leur mère. La chair de ces femmes est molle, et l’attaque d’une maladie les réduit en deux jours à l’état d’un squelette; leur chair n’a guère que la consistance du suif fondu, surtout dans les fesses. Cette particularité ne peut-elle pas être occasionée par l’habitude de rester continuellement assises quand elles n’ont rien à faire. Elle sont extrêmement lascives, et elles ont rarement plus de trois enfans.
J’ai assisté à deux accouchemens de négresses, l’une était mon esclave, l’autre était libre. Elles souffraient d’une hémorragie qui semblait menacer d’un accouchement malheureux, cependant toutes deux furent délivrées sans peine. Les os du bassin étant plus écartés chez elles que chez les blanches, leur épargnent les terribles douleurs qui souvent conduisent celles-ci au tombeau. On ne peut croire chez ces peuples que l’enfantement puisse donner la mort.
Il est rare qu’une femme avorte, à moins qu’il ne lui arrive un accident très grave. Elles sont vieilles et cessent d’être fécondes à vingt-cinq ans. La stérilité est un déshonneur chez ce peuple.
La menstruation n’est pas très abondante, elle est de 1 à 2 onces chez les jeunes filles, de 5 à 6 onces chez la femme mariée, et elle s’élève jusqu’à 7 à 8 onces chez celle qui a eu deux enfans. Les femmes sont presque toutes réglées en allaitant leurs enfans, mais la menstruation ne s’élève que de 3 à 4 onces au plus. Les enfans croissent avec une rapidité étonnante, et leurs organes se développent très vite, principalement dans le sexe féminin. L’allaitement se prolonge jusqu’à ce que l’enfant ait environ trois ans, et quoique la mère devienne de nouveau enceinte, elle continue d’avoir du lait et de nourrir son enfant. Lorsqu’elle accouche, le nouveau-né partage le lait de sa mère avec l’autre enfant qui a quelques fois plus de deux ans. L’accouchement n’interrompt presque pas les travaux des femmes. Elles vaquent à ceux de leur ménage dès le premier jour. Elles ne se renferment chez elles que lorsque la menstruation les fait fuir la vue de l’homme. Elles travaillent toujours avec leurs enfans sur le dos, elles se livrent même à leurs danses et à leurs plaisirs, sans jamais les quitter. Ces enfans crient rarement; ils paraissent supporter le mal avec plus de courage que les blancs. Dès leur plus jeune âge, ils s’accoutument à rester assis, et ils passent des heures entières sans remuer. Chez les enfans, la dentition s’opère sans les faire souffrir; ils sont peu sujets aux vers, et en général aux maladies.
Les femmes ne confient jamais leurs enfans aux soins d’une étrangère.
La virginité n’est pas en honneur chez ces peuples. Quand un homme prend une épouse, peu lui importe la conduite antérieure de cette femme. Les chefs et le souverain, dans tous les lieux, offrent leurs filles aux étrangers, pour le temps qu’ils resteront dans leurs états, quand ceux-ci sont leurs égaux en rang, ou qu’ils en attendent quelque faveur. Refuser une femme ainsi offerte est un affront sanglant et qui ne se pardonne pas. Les chefs des peuples qui habitent le long de la côte où l’on fait la traite, offrent leurs filles aux blancs ou aux mulâtres, pour en recevoir des présens, ce qui n’empêche pas qu’elles se marient peu de temps après; leurs maris les estiment autant et peut-être plus que si elles étaient vierges. Les enfans qui naissent du commerce des blancs avec les négresses, vivent très rarement; ceux qui atteignent l’âge de douze et quatorze ans meurent de langeur par suite des maladies qui les ont tourmentés depuis leur naissance. Leur corps n’est pas assez robuste pour résister au climat et aux fatigues du genre de vie des nègres.
J’ai vu chez Megna Candouri, sobetta du Haco, près les confins du territoire portugais, le fils d’une négresse et d’un mulâtre dont l’aspect me frappa. Les yeux de ce garçon étaient rouges, son corps tacheté de noir et de blanc, il ne sortait que le soir, la lumière du jour gênait sa vue, il était faible, sans courage et incapable de se procurer sa subsistance, ni même de se la faire servir. Jamais il n’avait pu se livrer à aucun travail, il était presque toujours malade, cependant il avait atteint l’âge de 16 ans environ.
Maladies. Les maladies épidémiques sont inconnues; mais celles qui dépendent de la qualité de l’air, de l’eau du terrein, de la chaleur, de la nourriture, de la manière de vivre, sont communes. La goutte tourmente les peuples peu éloignés de la côte, elle provient de l’usage immodéré du tafia et des boissons enivrantes faites dans le pays, ainsi que de l’abus des plaisirs sensuels; sur le bord des grandes rivières où le poisson abonde, règne le prurit, maladie terrible. La peau devient extrêmement sensible, surtout aux parties génitales; les accidens qui se manifestent, ont fait croire aux blancs qui fréquentent la côte, que c’était la maladie vénérienne.
Quelquefois des maladies sont causées par la disette; par exemple la dyssenterie.
La petite-vérole n’est pas endémique dans ces pays. Elle est totalement inconnue dans ceux qui sont situés à plus de 60 à 80 lieues des côtes. Sur le littoral au contraire, elle exerce de grands ravages; des provinces entières sont dépeuplées par ce terrible fléau que les Européens ont apporté. Je crois qu’il en est de même de la maladie vénérienne ne l’ayant observée que dans le voisinage des côtes ou dans les lieux que les mulâtres marchands ont fréquenté.
La loi qui, chez les nègres de l’intérieur, interdit à l’habitant d’un pays la faculté de pénétrer dans les états d’un souverain voisin, sous peine d’être fait esclave, contribue beaucoup à empêcher que les maladies qui infectent le littoral ne se propagent.
L’humidité occasione aux habitans du pays plusieurs maladies, qui ne se développent néanmoins que dans le temps des chaleurs et de la sécheresse, telles que le scorbut, les tumeurs indolentes, les obstructions des viscères, la paralysie de tous les membres. La chaleur excessive qui suit les temps des pluies dessèche promptement les marais qui répandent les exhalaisons les plus insalubres.
J’ai parlé assez amplement de la manière dont ils se traitent dans leurs maladies pour ne pas revenir sur ce sujet.
Moeurs et Coutumes. En parlant des différentes peuplades que j’ai vues, j’ai noté dans ma relation ce qui les distingue: mais en général, toutes ont dans la physionomie quelque chose de brusque, et même de féroce. Ils ont l’air sérieux, et cependant assez ouvert; ils rient assez volontiers quand l’occasion s’en présente et même aux éclats: ils aiment à faire des plaisanteries et à jouer des tours.
Ils ont l’esprit lourd, ils apprennent difficilement, ils se livrent avec une espèce de fureur aux plaisirs des sens; ils sont généralement paresseux, la réflexion semble être pour eux une opération pénible; de sorte qu’on serait tenté de les regarder souvent comme des êtres stupides. Parmi le grand nombre de nègres qui m’accompagnaient, et qui étaient l’élite des peuples chez lesquels je passais, je n’en ai jamais trouvé un qui pût aviser au moyen de traverser une rivière dans les endroits où il n’y avait pas de pont, ni qui sût même construire un radeau, ou s’en servir lorsqu’il était fait.
Ils ne connaissent d’autre bonheur que celui de ne rien faire. Quelques-uns passent leur temps dans la plus complète inactivité, et ils restent des demi-journées entières dans la même position, assis sous un arbre ou devant la porte de leur cabane les yeux fixés sur un objet. D’autres nègres au contraire sont d’une activité qui ressemble à la pétulance; ils n’ont réellement que de l’étourderie, car ils fuient tout ce qui exige le moindre travail.
Quelques autres tiennent le milieu entre ces deux excès; mais le caractère général de leur espèce semble leur interdire tout ce qui demande de l’application. Les nègres des pays où j’ai voyagé n’ont aucun animal domestique. Les habitans de la province d’Ambacca, dans le royaume d’Angola, sont les seuls, ainsi que je l’ai dit, qui aient su dompter le boeuf, et s’en servir comme de bêtes de sommes.
Ils aiment beaucoup la chasse, et s’y livrent avec courage. Ils sont très portés à la débauche, ils leur faut absolument plusieurs femmes. C’est peut-être la cause pour laquelle il naît plus de femmes que d’hommes. J’ai compté les enfans dans plusieurs lieux habités. Je présente dans les tableaux qui terminent mon ouvrage le résultat de mes recherches.
Les nègres de l’intérieur sont moins paresseux que ceux qui habitent près des côtes. Ceux-ci sont gouvernés par un grand nombre de petits chefs indépendans, qui exercent une autorité souveraine et sans contrôle, et dont le despotisme ressemble à l’arbitraire. Ceux de l’intérieur obéissent de même à beaucoup de petits chefs; mais ces derniers ne sont réellement que les vassaux des souverains puissans; or, tout habitant du pays qui se croit lésé, peut avoir recours au potentat.
Je n’ai réellement trouvé de l’industrie que chez les Moluas, qui exploitent et façonnent les métaux et savent tailler les pierres fines. Le commerce de peuple à peuple est à-peu-près inconnu, à l’exception du trafic des esclaves.
L’esclavage doit avoir considérablement diminué la population des contrées que j’ai parcourues, elle serait sans doute plus considérable, si la traite des nègres n’eût jamais existé. La quantité d’hommes enlevés annuellement de ces pays ne pouvait être compensée par les naissances.
Je pris partout où je passai des notes pour connaître l’époque à laquelle on faisait remonter le commencement de l’esclavage. Les chefs m’ont toujours répondu qu’ils avaient appris de leurs pères que, de toute antiquité, il avait existé. Chez les Molouas, l’on m’assura qu’il y avait toujours été connu, et que selon une tradition très ancienne, le nombre de ceux que le souverain doit posséder, et garder pendant son règne est de huit cent quarante (mubica hama naqui macugni auana); il ne peut vendre ni donner que le surplus de ce nombre. Le souverain Holo Ho, a aussi des esclaves qu’il ne peut jamais vendre. J’ai déjà dit que l’esclavage chez ces peuples, avant que les blancs fissent la traite, ne différait pas de la domesticité chez nous, sinon que l’homme n’était pas entièrement maître de sa personne. Chez les Molouas et dans les états de Bomba, un esclave peut se faire remplacer par un parent ou toute autre personne qui y consent; de plus, il ne peut être vendu pour être conduit chez un peuple étranger, à moins qu’il ne commette un crime. Les enfans naissent libres.
Chez les nègres, les esclaves qui existaient avant la traite étaient comme les servi des anciens Romains, réduits à une simple domesticité.
Lorsque l’on fait le partage des prisonniers de guerre, on les examine très soigneusement; on regarde surtout leurs dents, leur langue, leurs gencives; on tâte leur chair, on leur fait lever des fardeaux pour connaître leur force, on s’informe exactement des femmes si elles ont eu des enfans.
Les nègres, comme je l’ai dit plusieurs fois, mangent beaucoup moins que les blancs. Quoiqu’ils aiment de préférence la viande, ils sont très souvent forcés de s’en priver, puisqu’ils ne savent pas élever des animaux domestiques, et se trouvent réduits à profiter des produits incertains de la chasse. Les guerres fréquentes causent des disettes. Je dois ajouter à ce que j’ai dit de leur nourriture qu’ils mangent aussi les sauterelles (gryllus migratorius). Ils les font griller dans un vase de terre qu’ils mettent sur le feu, et n’y ajoutent aucune espèce d’assaisonnement; ils leur trouvent un goût si exquis, qu’ils les joignent à leur fungi ou bouillie, pour en relever le goût.
Les nègres qui sont voisins de l’équateur et qui ne se nourrissent que de végétaux, supportent moins la fatigue que ceux qui sont plus éloignés de la ligne, et auxquels la chasse fournit de la chair.
Dans le territoire d’Ungeno, j’ai vu des nègres qui mangeaient de la terre lorsqu’ils voulaient se faire du mal, et ils y réussissaient. L’estomac ne pouvant pas digérer cette substance, il leur survenait des obstructions qui ne tardaient point à les conduire au tombeau. Cette coutume n’est pas générale et ne s’observe que dans quelques villages. Je n’ai jamais vu que des esclaves qui eussent recours à ce moyen de se détruire.
Tous les peuples que j’ai visités jusqu’à 0º 30’ au nord de l’équateur parlent la langue mogialua, dont l’abunda n’est qu’un dialecte; ensuite j’ai trouvé des peuples dont la langue est totalement différente. Mais s’ils diffèrent à cet égard, leur religion est la même, partout le fétichisme le plus grossier domine, et les jongleurs savent comme je l’ai raconté plusieurs fois, profiter de la superstition de ces peuples.
Les fétiches consistent en figures d’hommes ou d’animaux grossièrement taillées: il y a aussi des fétiches vivans, par exemple des animaux, qu’ils élèvent avec le plus grand soin, ils consacrent à leur service des jeunes garçons et des jeunes filles. Ils adorent leurs dieux, non par crainte, mais par l’espoir de se les rendre favorables; quelquefois un arbre sur pied est fétiche; mais je n’ai vu aucun autre objet qualifié ainsi; ils croient à une sorte de métempsycose.
Tous ces peuples sont polygames. Les femmes sont persuadées qu’elles n’ont été créées que pour les plaisirs de l’homme. L’enfant mâle quitte la maison paternelle à l’âge de 5 ans. Le fils n’hérite point de son père, mais aussi il ne peut être condamné à l’esclavage pour les crimes que celui-ci commet, qu’après la mort de tous les neveux du côté maternel. J’ai parlé de ceux de ces peuples qui sont antropophages.
On voit par mon récit qu’il faut beaucoup rabattre de ce que les anciens voyageurs ont raconté de la barbarie révoltante de ces nègres. J’ai pris à ce sujet les informations les plus minutieuses, et j’ai constamment eu pour réponse à cet égard comme sur la plupart des autres points que les usages n’avaient subi aucun changement; comme leurs idées sur l’humanité diffèrent totalement des nôtres, on ne peut raisonnablement supposer qu’ils aient caché la vérité, car ils n’avaient dans leur opinion ni à se justifier ni à s’excuser d’actes qu’ils ne regardent que comme indifférens.
Malgré la forme despotique du gouvernement de quelques cantons, il y a presque partout un frein opposé à la volonté arbitraire du chef, et qui consiste dans l’usage; car aucun de ces peuples ne connaît l’écriture. Mais chez eux, la coutume a force de loi; j’en ai cité beaucoup d’exemples. Je n’ai rencontré des peuples errans, c’est-à-dire sans demeures fixes, et qui semblaient ne faire partie d’aucune nation, que sur le haut de quelques montagnes, entre les territoires de Bihé au sud, et de Cunhinga au nord.
Les nègres habitent indifféremment les collines, les montagnes ou les vallées. Ils ne cherchent, pour établir leur demeure, que le voisinage d’un ruisseau. Ils sont très propres. Ils se baignent le matin dans l’eau courante, la plus proche de leurs cabanes. Ils se lavent les mains avant de manger, et la bouche et les mains après chaque repas; ils ne se couchent jamais sans faire leurs ablutions, quelque rare que soit l’eau. La chaleur que l’on respire dans ces climats brûlans, semble ranimer le nègre et lui redonner des forces.
Avant de terminer, je dois dire un mot sur l’origine des noms d’Angola et de Congo.
Les informations que j’ai prises dans les possessions portugaises, et chez Ginga, s’accordent sur l’origine des habitans de ces contrées. Ils appartenaient jadis à une nation vivant dans le nord-est. En poussant ses conquêtes dans diverses directions, cette nation était arrivée sur cette partie de la côte d’où les peuples qui l’habitaient s’étaient enfuis vers le sud. Ce peuple conquérant s’appelait Moloua, qui signifie, dans leur idiome, souverain chef (mo, souverain, loua chef). La mortalité ayant à cette époque causé des ravages terribles, les prêtres, fatigués sans doute des déplacemens continuels qui les privaient de repos, déclarèrent que les dieux demandaient à retourner dans le pays d’où l’on était venu.
Cette décision fut suivie, mais il resta dans les cantons que l’on quittait une colonie, puisque l’émigration avait été occasionée par l’excès de la population. Cette colonie porta dans l’origine, le nom de Memba Moloua, peuple du souverain chef; mais comme on les appelait plus communément, Abunda, les conquérans, cette dernière dénomination a prévalu chez les Molouas et chez le souverain Macocou, dont les états sont limitrophes, et qui s’étaient joints ensemble par un traité, lors de ces conquêtes: on donne même encore le premier nom aux peuples de cette côte.
Cette contrée ayant été reconquise dans la suite, par un chef du Congo, nommé Angola, elle prit ce nom. Mais celui que la langue avait reçu chez le peuple voisin, qui ne le connaissait pas, resta. Elle est encore appellée Ririmi Abunda, langue des conquerans, et par abréviation Abunda. D’après ce que je viens de dire, on voit qu’elle dérive de celle du pays Moloua. Celle-ci s’appelle Mogialoua, langue souveraine.
Ce peuple et les habitans du royaume d’Angola: se comprennent encore aujourd’hui entre eux.
Les Molouas m’ont expliqué la signification du nom Mongo qu’ils donnent à l’idiome Congo. Mo veut dire, maître, souverain, et Ngo, étendue d’eau, mer; maître de la mer, parce que les états du roi de Congo sont situés le long des côtes, et que de plus, il se regarde comme le maître des terres qu’il suppose être couvertes de la mer.
De même que dans plusieurs autres pays les Européens ont altéré le nom de cette contrée. Les nègres prononcent le mot Mnongo, de manière que l’oreille croit entendre nongo. En général leur articulation est sourde et gutturale. Or un Portugais aura cru ou supposé qu’il y avait un C au commencement du mot. Combien d’exemples n’avons-nous pas de transformations encore plus singulières.